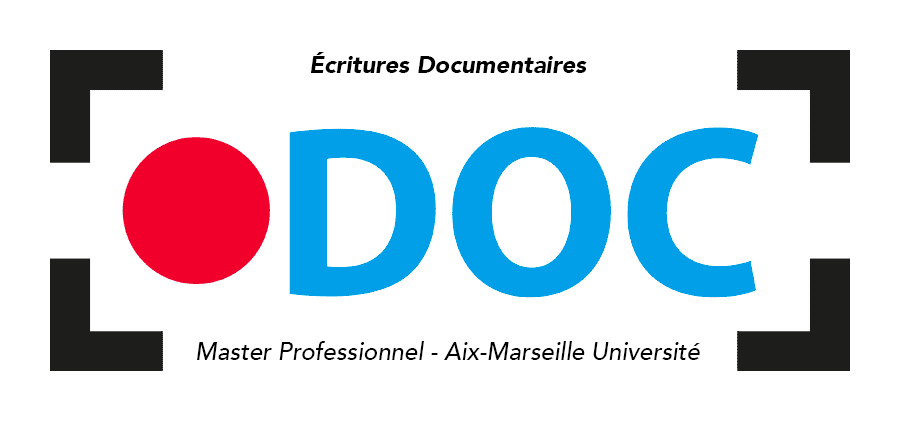Cet OPNI, Objet Parlant (et bavard) Non Identifié, aurait pu être un film si quelqu’un avait pensé à couper la bande son. Or, de l’écriture à la projection, ça n’a traversé l’esprit de personne, dommage.
Suffit-il de filmer une artiste géniale pour faire un film génial? De toute évidence non. Pour cela, il aurait fallu que le réalisateur ait un tant soit peu d’estime pour son sujet. Or, du point de vue du spectateur, le tournage paraît n’être que le fruit d’un opportunisme insupportable. Du réalisateur d’abord, mais aussi des assistants de Yayoi qui sont omniprésents dans le cadre. Passer 40 ans de sa vie au service d’une personne psychotique, implique un investissement total et représente un dévouement louable. Mais lorsqu’elle est peintre, mondialement reconnue, cela relève davantage d’une vie par procuration. Et la seule chose que Matsumoto arrive à faire (sans le savoir) c’est que nous, spectateurs, trouvions ça suspect. Même pas malsain. C’est pour dire à quel point il est passé à côté de la relation.
En même temps, c’était difficile d’avoir du recul, préoccupé qu’il était à organiser la voix off de la narratrice. A ce stade là, le récit se transforme , et par là même, la vie de Yayoi (ce qui est plus grave encore) en une suite interminables de coupures de presse. Cette narratrice, dont la prononciation m’a renvoyée à mes premières leçons d’anglais sur magnétophone, énonce de façon journalistique ce que nous voyons à l’image, et que les personnages se disent entre eux. Existe-t-il un terme pour désigner cela ? « Doublement redondant », peut-être.
Tout dire, très vite, de façon anecdotique puisque le film entend retracer 82 ans d’une vie de singularité et de création en 49 minutes. Malheureusement, ce n’est pas tout, pour gagner du temps, l’usage du time remap systématique sur la réalisation des toiles grand format nous invite à voir le génie en action. Et ainsi la recette de l’oeuvre. Alors je me demande, si on avait passé l’OPNI en accéléré, aurait on obtenu de l’art pour autant?
Le clou, parce qu’au milieu de cette marmelade, il y en a un, c’est que le réalisateur a gardé le meilleur « cliché » pour la fin. Je vous laisse juger : deux monstres de l’intégrité artistique qu’on a jugé bon de rassembler le temps d’un générique, Bjork et Kusama.
Pourtant, c’est possible de traiter le génie artistique et la maladie mentale avec l’humilité et le respect que cela implique. Il n’y avait qu’à être présent à la projection de « Pictures of Susan » de Dan Salmon. Susan est autiste, ne parle plus depuis l’âge de quatre ans, elle en a plus de 60. Contrairement à Kusama, elle ne vit pas dans un hopital psychiatrique mais avec sa famille, nombreuse, aimante. Sa production artistique, au moins en termes de quantité, est aussi importante que Kusama. Dix mille dessins sur une vingtaine d’années. Alors qu’est-ce qui fait que ce film va au-delà de la vie incroyable de Susan ? Peut-être, la distance juste entre la caméra et Susan, qui nous permet de déceler la lueur de fierté dans ses yeux quand le galeriste admire et commente les dessins de Susan ; de la distinguer de celle qui pointe lorsqu’elle déambule les mains dans le dos le jour du vernissage.
Peut-être est-ce parce que c’est sa famille qui prend en charge la parole et l’histoire de Susan. Sans jamais chercher à comprendre ni expliquer, juste une grande dose d’amour qui ressort de ces bribes. Et c’est ce qui rend évident l’apparition des photos de Susan enfant alors que celles de Kusama étaient anecdotiques. Le time remap est aussi utilisé mais avec parcimonie, et surtout n’a rien de spectaculaire. On y voit Susan qui s’arrête pour aller se faire une tartine. Et évidemment personne pour commenter que Susan a faim et qu’elle mange sur le pouce pour se remettre au travail le plus rapidement possible.
Bref des moyens d’expression communs, et pourtant d’un côté un film, de l’autre…
Corinne Vicari