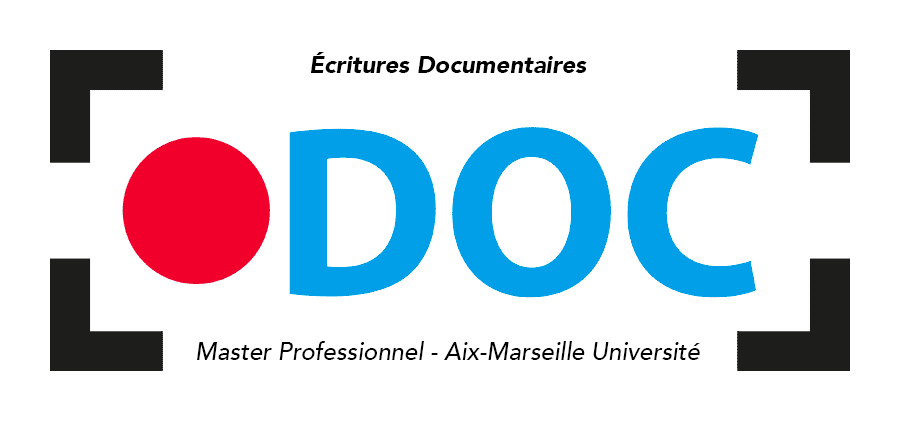ONCE MY MOTHER
Sophia Turkiewicz
Sophia Turkiewicz, jusqu’ici réalisatrice de films de fiction, fait, avec ce premier documentaire, le récit de deux vies étroitement mêlées : celle de sa mère et la sienne. Alors que cette dernière vieillit et perd progressivement la mémoire, la réalisatrice décide de reconstituer ses bribes de vie à travers un savant mélange d’images d’archives, d’extraits de ses propres fictions et de leurs deux paroles respectives.
Un jeu de questions/réponses entre les deux protagonistes se met en place dès que la réalisatrice pose l’enjeu du film : son abandon mystérieux par sa mère lorsqu’elle avait une dizaine d’années. La quête commence justement lorsque la mère, au même âge, vit dans la Pologne des années 1940. Déportée dans un camp de travail en Russie, elle est l’une des rares à survivre à la fin de la guerre. Après un passage dans un camp de réfugiés africain où elle met au monde sa fille unique, elle s’installe définitivement dans la ville d’Adélaïde en Australie où elle décède en 2010.
C’est un récit de vie personnel, unique en son genre et pourtant universel dans la forme qu’il prend. On est bien sûr touché par la force du personnage maternel mais les images d’archives des camps de travail et les visions de ces files d’hommes et de femmes dans les goulags ajoutent au film toute sa portée historique. Alors que le sujet, extrêmement personnel, pouvait facilement laisser le spectateur sur le pas de la porte, le dispositif l’invite non seulement à redécouvrir un épisode dramatique du XX e siècle mais aussi en quelque sorte à le vivre aux côtés du personnage de la mère. L’empathie du spectateur est directe car elle est nourrie du récit oral des deux femmes mais aussi et surtout des images qui sont toutes des mises en situations très efficaces. Quand ce ne sont pas des images d’archives véritables, ce sont des extraits des fictions de Sophia directement inspirées de la vie de sa mère. Silver City, par exemple, est un film qu’elle réalise en 1984 dans lequel une mère et sa fille polonaises émigrent en Australie à la fin de la seconde guerre mondiale. Quoi faire alors de mieux que de combler les vides de la mémoire maternelle par l’image du débarquement, tirée du film, pour montrer celui d’Helen et de Sophia? Ainsi, chaque événement, chaque avancée du récit sont nourris d’images fortes et simples.
La petite histoire passe par la grande Histoire. Les descriptions des marches sans fin, des travaux épuisants, de la famine consistent en de petites anecdotes racontées par la mère à la fille. La ration de pain volée à une voisine de chambre qui meurt quelques heures plus tard, les premières menstruations alors qu’il n’y a aucune hygiène possible dans le camp. Petit à petit, les petites histoires s’imbriquent les unes avec les autres, les images se répondent comme elles le font dans l’esprit de la réalisatrice. La survie d’abord inexplicable de Helen devient envisageable, crédible.
Les extraits des films réalisés plus tôt par Sophia Turkiewicz montrent une grande envie et un vrai besoin de transformer la vie de la mère en fictions et en récits, joués par d’autres, vécus par d’autres. L’acte de les utiliser au sein même d’un documentaire montre l’impossibilité d’échapper à cette mise en fiction. Le montage, très découpé, utilise tous les ressorts dramatiques d’un conte avec son héroïne, ses épreuves, ses victoires, ses échecs et sa fin. Heureuse, la fin, pour équilibrer l’ensemble et le début difficile.
Le tout est ponctué de deux entretiens avec la mère à deux âges différents, l’un vers quarante ans, l’autre bien plus tard vers quatre-vingts ans. La voix de la fille est très fluide, sans aucune faute de langage, tandis que celle de la mère est hésitante, chevrotante et pleine de fautes d’anglais. L’écart entre les deux femmes, les deux époques, les deux parcours de vie est audible. Cette comparaison ne se fait pas sans aborder la question de la transmission mère/fille. Question qui atteint encore une fois une portée universelle. Sophia le dit clairement : à travers l’histoire de cette mère, elle raconte aussi son histoire. Le besoin, nécessaire à sa survie, à sa prise de maturité, de s’approprier les histoires entendues enfant en les comprenant, en les rangeant dans le bon ordre.
Ce qui ressort finalement de ces paroles et de ces deux portraits de femme est une puissante déclaration d’amour à la mère, qui elle-même en fait une à son pays d’accueil. Le spectateur ressent aussi fortement que la réalisatrice le sentiment d’achèvement de quelque chose, commun aux deux personnages. La mère est arrivée dans son foyer, comme elle appelle l’Australie, et la fille est arrivée à comprendre sa mère et ses racines. Une histoire s’achève.