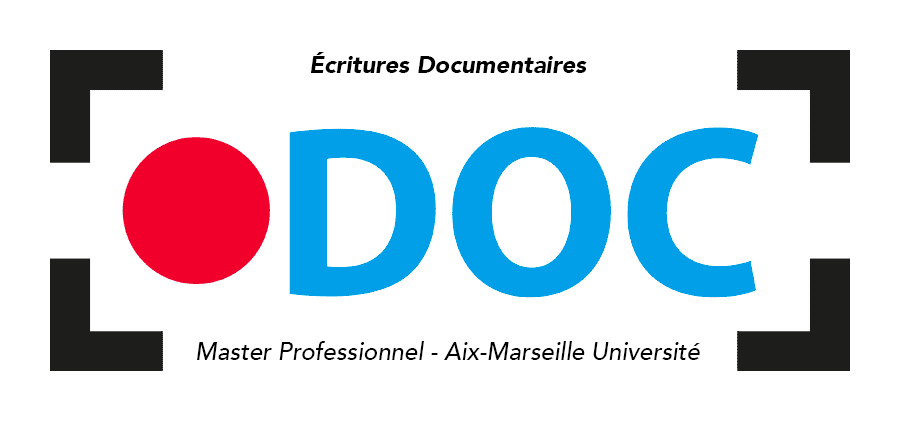Il y a cette image iconique au tout début de Bob Wilson’s Life and Death of Marina Abramovic (BWLDMA) : le visage de l’artiste, maquillé en blanc, aux sourcils noirs et à l’expression dramatique, devant un fond rouge sang qui, on l’apprendra plus tard, représente en fait un gigantesque drapeau soviétique. Elle crache des sons animaux, entre chants et hurlements. C’est une image plus grande que la vie, à la fois sublime et pathétique jusqu’au ridicule et l’effet qu’elle a finalement sur la perception que nous avons de son sujet est fatal : au lieu d’être introduite comme une présence monumentale, comme c’était sans doute l’intention, Abramovic est dévoilée comme un vestige, une survivance d’une autre époque. On se croirait transporté dans les années 80, dans les manifestations théâtrales de la culture camp new-yorkaise d’un Klaus Nomi, du jeune David Bowie et des autres maîtres de l’auto-mise en scène sémi-ironique d’une décennie trash et sans peur des apparences baroques.
Robert Wilson et Marina Abramovic : c’est une combinaison qui paraît si évidente qu’on se demande pourquoi leurs chemins ne se sont pas croisés il y a longtemps déjà. Comme personne d’autre, Abramovic a fait du corps (le plus souvent du sien), de ses gestes et mouvements, de sa violence et de sa sexualité, le matériau de son art. En le soumettant à des procédures au début simples et rituelles, puis de plus en plus théâtrales et narratives, elle a créé une œuvre qui n’a qu’un seul sujet : la biographie et l’univers intérieur de sa créatrice, ses désirs et ses blessures. Abramovic a transformé le narcissisme en art (et non, ce n’est pas une insulte). Avec Wilson, elle partage la sensibilité du geste, le goût du rituel archaïque et le brouillage des frontières entre théâtre, installation et sculpture dans l’espace. Mais il y a encore d’autres parallèles : tous les deux sont porteurs d’une étiquette « d’avant-garde » qui manque un peu de justification depuis un moment déjà. Tous deux ont développé des œuvres fort cohérentes et fascinantes par leur stylisation mais, pour les mêmes raisons, aussi très homogènes. Le spectateur qui a vu deux ou trois extraits des travaux de Wilson sur YouTube aura facilement l’impression d’avoir une idée assez précise de son œuvre ; il n’aura pas forcément tort.

BWLDMA est un commentaire, plutôt qu’un making-of, d’un projet théâtral que les deux artistes ont développé avec un grand nombre d’illustres collaborateurs, dont Willem Dafoe et Antony Hegarty : un spectacle scénique qui propose de raconter la vie d’Abramovic, de son enfance en Serbie jusqu’à son enterrement imaginé, sous la forme d’une sorte de revue musicale style Broadway (sauf qu’on est ici plus proche de Stockhausen et de Brian Eno que des Misérables).
La construction du film est très simple : des extraits du spectacle ou des répétitions (suivant largement la chronologie de la pièce) sont entrecoupés de commentaires des quatre protagonistes. C’est avant tout cette alternance statique d’extraits et de talking heads qui laisse penser à un bonus de DVD où le commentaire explicite ce qui se passe et l’image illustre ce qui vient d’être dit.
A l’exception des commentaires, l’esthétique du film repose en grande partie sur celle du spectacle qu’il propose de documenter, au point que la réaction du spectateur dépendra très largement de son appréciation du travail de Wilson et Abramovic. La question qui se pose est donc : est-ce un film ?
A part quelques moments de grâce cinématographique, la réponse est Non. Giada Colagrande s’est plus ou moins contentée de nous livrer une captation de spectacle. Des plans d’ensemble pour les scènes d’ensemble, filmés frontalement de la perspective d’un spectateur (muni d’un billet coûteux) ; des gros plans de visage pour les quatre stars. Caméra le plus souvent statique ; pas d’expérimentation sur les angles de prise de vue. Le film se contente d’une discrétion soignée, d’un désir de mettre tranquillement en valeur ce qui se passe sur scène sans y apporter ni commentaire ni « interprétation ». On est fermement ancré dans une tradition sage et artisanale du théâtre filmé. Il y a parfois des éléments de making of, mais il n’y a jamais l’ambiance fiévreuse d’un travail scénique sur le vif. Les acteurs sont toujours présentés en costume et ce n’est souvent pas clair s’il s’agit d’une répétition, du spectacle devant un public ou, comme on peut le soupçonner, d’une représentation spéciale pour la caméra. Le spectacle semble achevé dès le début et les glissements incessants et souvent imperceptibles entre répétitions et représentation résultent en l’impression que le film ne s’intéresse pas vraiment à ce qu’est le travail scénique. Il y a une incertitude par rapport à ce qu’on voit : est-ce un clown macabre faisant penser au Joker de la série Batman qui sert de narrateur de la pièce ? Ou plutôt l’acteur Willem Dafoe qui travaille son incarnation de ce personnage ? Les frontières entre la réalité théâtrale et la réalité d’un théâtre se brouillent sans que cela nous permette une compréhension privilégiée des activités sur scène.
Il n’y aurait rien à reprocher à une démarche discrète et fidèle au spectacle qu’elle documente. Le problème fondamental n’est pas dans l’esthétique du film, mais dans son attitude à l’égard de ses protagonistes : c’est celle de l’adulation fascinée. Ainsi, une phrase comme « Notre âme communique avec celle de Marina à des niveaux absolument élémentaires » peut passer sans ironie. A aucun moment le film ne fait l’effort de prendre une distance critique ou curieuse par rapport à ses stars auxquels il s’efforce de servir simplement de plateforme d’une mise en scène révérencieuse. Leurs commentaires forment finalement un texte continu, un éloge à quatre voix qui se confirment mutuellement leur importance. Bob Wilson, c’est un mec génial, non ? Et d’autant plus si c’est Willem Dafoe qui le dit, parce que tout ce qu’il dit, c’est profond, you got it, baby ? Maintenant, la branlette collective est certes plus jouissive que le même acte exécuté en solitaire, mais ça reste de la masturbation.
Comme les extraits du spectacle, les talking heads sont filmés de façon très classique. Leur intérêt dépend alors entièrement de qui parle. Ça peut être académique (Wilson), respectueux et pertinent (Hegarty), emphatique (Abramovic) ou simplement sublime (Dafoe).
A tout moment, il est passionnant de voir à quel point Willem Dafoe ravit la vedette aux autres. Pour moi, le plaisir suprême en voyant ce film a été de redécouvrir ce comédien, une véritable bête de scène. En dépit de Platoon, La dernière tentation du Christ et Antéchrist, j’avoue que ce n’est qu’avec BWLDMA que j’ai réellement compris quel immense acteur est Dafoe. On se surprend à ne plus écouter ce qu’il dit, tel est le plaisir physique de le voir parler. Il y a un moment dans le film où, lors d’une répétition, Wilson annonce que c’est l’anniversaire du conseiller musical. Tout le monde se met alors à chanter Happy Birthday, tandis que Dafoe, debout sur une chaise, se plonge dans une petite improvisation, de manière presque compulsive. Ses gestes, ses expressions, ses sourires, tout est d’une énorme précision, mais d’une précision absolument spontanée et naturelle, comme les mouvements d’un chat. C’est un des rares instants où le film arrive enfin à s’envoler vers la magie du théâtre.
A partir d’un certain moment, il apparaît que ce n’est un film ni sur Bob Wilson ni sur Abramovic mais sur ce que fait Dafoe en transformant leurs mots en incarnation chauffée à blanc. La caméra semble l’aimer plus que les autres, elle lui laisse à juste titre une place privilégiée et ce n’est probablement pas un hasard : Colagrande et Dafoe sont un couple marié depuis des années.
C’est peut-être là la plus grande force et le plus grand défaut de Bob Wilson’s Life and Death of Marina Abramovic : c’est un travail d’amour plus que d’inspiration.
Martin Lampprecht