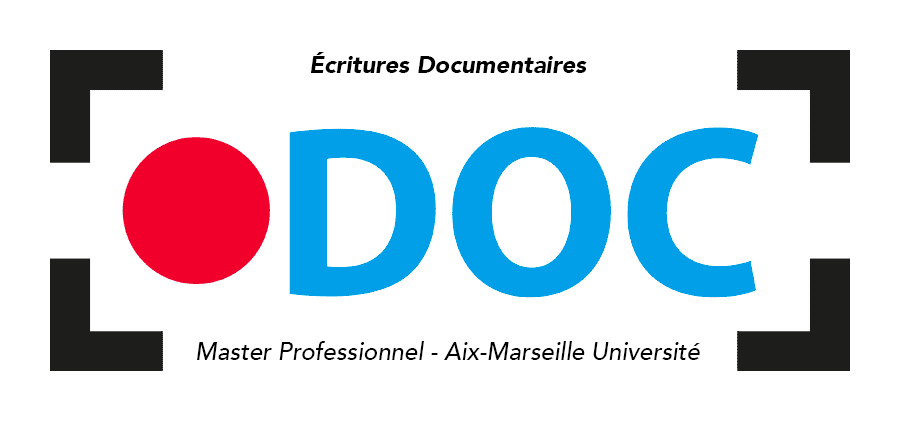La programmation Jeune Création de la vingt septième édition du FIPA nous offrait cette année plusieurs fenêtres sur les films d’étudiants de diverses formations cinématographiques à travers le monde. L’une d’elle était consacrée aux productions de l’Université de Stanford en Californie.
Avec une sélection de six films, c’est un panel éclectique non seulement par leur thématique mais aussi par leur rapport au monde que les étudiants Américains nous proposaient aujourd’hui.
Un réel voyage allant de l’Inde jusqu’au Dakota du Nord enneigé en passant par les affaires d’une grand mère Chinoise récemment disparue, une vraie diversité dans le style allant du Michael Moore de l’entomologie au film personnel.
On retiendra notamment l’étonnant White Earth de James Christian Jensen. Étonnant pour la justesse de son propos mais également pour son choix de donner la parole aux enfants pour parler d’un phénomène que l’on s’attendrait a priori à voir décrit avec des mots d’adultes : à savoir l’exploitation pétrolière.
Depuis les années soixante la petite ville de White Earth située dans l’état du Dakota du Nord a vu arriver avec l’installation de l’exploitation pétrolière des personnes venant des quatre coins des États Unis pour chercher du travail. Le quotidien et l’organisation de la ville en ont été chamboulés. Désormais, seuls les trains transportant le précieux pétrole semblent venir à White Earth.
C’est un portrait de ce microcosme particulier ( il y a cent habitants à White Earth) que nous content les enfants des parents employés sur les plateformes. Le tour de force du film est dans l’équilibre trouvé entre le regard du cinéaste et celui des enfants. On passe naturellement de cette petite fille mexicaine qui nous décrit son quotidien dans une des nombreuses caravanes qui s’entassent dans les champs de neige en bordure de la ville, à des plans des géantes silhouettes noires des puits de forage qui se découpent dans ce ciel aussi blanc que vide. Comme si White Earth vivait au rythme de leurs mouvements saccadés qui puisent sans fin l’or noir : véritables sentinelles d’un endroit au bord du monde.
Le discours des enfants, pour la plupart du temps monté en voix off sur des images d’eux en train de jouer dans la neige, est d’autant plus touchant que l’on voit bien qu’ils saisissent parfaitement la cruelle réalité du quotidien de leurs parents : travail harassant dans le froid, déracinement des familles, relations parfois inexistantes entre les originaires du coin et ceux venus de loin, salaires de miséreux. En attendant leur majorité, ils continuent de jouer avec leur chien et faire l’ange sur une mare gelée, conscients tout de même qu’un jour aussi peut être leur tour viendra d’aller remplacer leurs parents.
Un beau portait en somme de ces gens et de leurs familles et des conséquences par toujours très reluisantes et rarement évoquées du système d’exploitation pétrolier.
Un autre film étudiant, Grave Goods de Leslie Tai, raconte l’histoire très personnelle de sa grand-mère chinoise au travers des objets chers à son cœur qu’elle a laissé derrière elle après sa mort. Sur une petite table avec un fond bleu clair, les objets tournent sur eux-mêmes comme pour une exposition d’art. La réalisatrice raconte l’histoire de sa grand-mère à travers eux, et se demande que faire maintenant de tous ces objets qui sont dorénavant les siens, mais qu’elle ne pourra jamais considérer comme tel. Les images sont pimpantes, pleines de couleurs, la musique entrainante. Le tout est agrémenté de vidéos que Leslie avait pris de sa grand-mère depuis quelques années. Au travers la question difficile de la mort, ce documentaire nous propose une forme originale et drôle à la fois, d’une expérience très personnelle mais dans laquelle chacun arrive à se retrouver.
Ces films étudiants sont de vraies perles dans la programmation très formelle du reste du festival. Sans réelle contrainte de fond et de forme imposée par l’université, on se rend compte que les étudiants, « livrés à eux-mêmes » si l’on peut dire, laissent ainsi parler toute leur créativité et leur sensibilité. Et ça fait du bien.