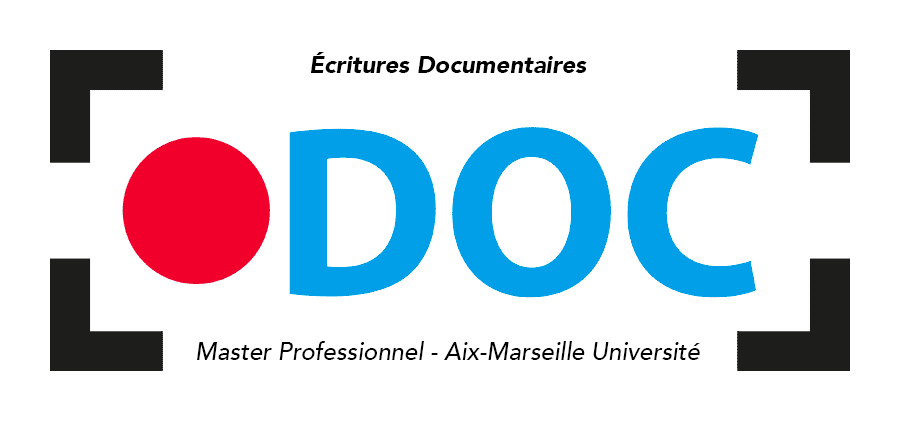Ce jeudi 31 janvier, quatre jeunes réalisateurs et leurs équipes ont offert à une salle remplie quatre films. Quatre films a priori très différents, sur des sujets riches et hétéroclites. 15 ans de JB s’attache à ces jeunes personnages des quartiers nord de Marseille, dans cette période où ils doivent faire des choix. Au sortir du collège, on leur demande de savoir ce qu’ils veulent faire ensuite.
Gare Gazette de Lola C suit les aventures d’un atelier de théâtre dans un centre pour personnes handicapées. Rue Curiol de Julian est une promenade dans cette rue de Marseille, qui amène rapidement le spectateur dans les intérieurs de celles que l’on voit toujours dehors. Trois prostituées polynésiennes de plus de cinquante ans.
Enfin, Je n’ai jamais quitté la foret de Martin, fait le récit intime d’une femme qui, comme le titre l’indique, n’a jamais quitté les arbres. Un récit intime qui met en lumière les rapports étroits et contrariés des hommes et des arbres.
Quatre films différents par leurs thématiques donc, mais qui ont cependant une constante. Celle de l’importance du temps, dans la mise en scène comme dans les autres partis pris. C’est d’abord l’entre temps dans le film de JB. C’est ensuite l’attente dans celui de Lola. Puis c’est le temps qui passe, le temps qui use dans Rue Curiol. Enfin, Martin fait l’exercice périlleux de la restitution des souvenirs des sens dans son film. Un voyage dans l’intime qui ouvre sur des questions universelles de survivance de la nature face aux hommes.
15 ans, l’entre temps
Qu’est ce que l’adolescence si ce n’est l’entre deux? Cette période de la vie est déjà marquée par cette mutation souvent laborieuse, pas un enfant, pas un adulte. Comme si ces caractéristiques phisyco-psychologiques n’étaient pas suffisantes, le cadre (parental, social, scolaire) demande en plus à ces jeunes de faire des choix. Jean-Baptiste filme alors comme point de départ les réunions d’orientations, symptomatiques du décalage entre ce qu’on demande aux jeunes garçons de savoir, et ce qu’ils savent vraiment. JB s’attarde sur les visages de ces adolescents, et ceux qui parlent sont souvent hors champs.
Il n’est pas question ici de pointer du doigt les institutions. C’est un point de départ pour traiter cet age délicat, et ce paradoxe entre le doute, l’insouciance, et les choix décisifs -ou non- que les personnages doivent faire.
Le réalisateur met en place une esthétique de l’errance. Entre les ages, entre les quartiers, entre les gens. La temporalité du film épouse la thématique. Le récit commence à la fin de troisième et finit au début de la suite. Entre temps, l’été est ce temps mort, ce temps incertain. Le temps de se créer un monde sur ce territoire extrêmement bien filmé. Le film, comme les personnages ne sont pas tournés vers les quartiers nord, mais vers le large ou vers la ville. La caméra s’enracine à l’Estaque pour
mieux filmer l’horizon.
Il en ressort une fresque de petits épanouissements personnels. Des plaisirs qui passent rarement par l’école, si ce n’est pour les rencontres qu’elle offre. L’important à quinze ans, c’est peut être de continuer à se construire son monde, entre la maison et l’école. Ce sont les plans de baignade tournés vers la mer, le plan séquence de l’entrainement de boxe, ou ceux de l’escapade dans ce garage en friche qui clôt le film dans cet espace temps suspendu.
Gare Gazette et l’attente Encore une fois, c’est la notion de temps qui prime sur ce film. Celui de l’attente,
mis en évidence par l’atelier de théâtre lui même
Attendre : « se tenir en un lieu où quelqu’un doit venir, une chose arriver ou se produire, et y rester jusqu’à cet événement ».
C’est à travers ça que Lola dresse le portrait de ces personnes et crée la poésie de son film. La réalisatrice alterne la vie et le théâtre jusqu’à la confusion des différents niveaux d’attente. C’est dans la vie l’attente d’une mère qui ne viendra plus. Au théâtre, c’est le train. Celui qui les emmènera loin, celui qui les déposera de nouveaux chez eux, celui qui leur permet l’évasion mais surtout celui qui n’arrive jamais.
Lola se sert de ce qui est mis en place dans ces ateliers de théâtre pour construire ses personnages et pour servir ce thème. On s’approche du clown et du burlesque. Les personnes ont déjà des caractères et des comportements plus exagérés que la moyenne. Sur émotivité, excitation, lenteur, peurs… Le paris d’en faire des clown est délicat. Mais il permet surtout de rire sans complexe. Les personnes s’amusent et embarquent les spectateurs. Difficile de faire la part des choses entre le « je » et le « jeu ».
Lola profite du cinéma pour déjouer le réel et la fatalité de l’attente. Pour le film, ses personnages prendront enfin le train. Qui prend ce train, les personnes ou les personnages? Peu importe. Puisque c’est ici la rêverie qui compte. Savourons les plaisirs du jeu, quitte à déchanter à l’arrivée en gare.
Rue Curiol et le temps qui use Ce film semble avoir des thèmes pluriels, et tend à s’unifier en partie grâce à cette
récurrence du temps qui passe et des métamorphoses.
Rue Curiol démarre par des plans de la rue qui paraissent énoncer un postulat. La rue Curiol est en pleine mutation. La construction du nouveau campus universitaire et les investissements immobiliers vont détruire une vie de quartier. C’est une forme de nostalgie, le constat de la surpuissance de la modernité -immobilière- sur le passé, incarné par des vies humaines plus vulnérables.
Ce postulat éclate au fil du film, il est évacué par le film lui même D’abord par les personnages qui crèvent l’écran. Le thème de la rue est rapidement remplacé par l’histoire de ces femmes. La rue Curiol devient le décors qui nourrit les personnages et
leurs parcours. Le film s’attache à des personnages récurrents, comme la vieille femme qui passe tous les jours et qui fait fit des barrières des chantiers. Ou comme le coursier qui continue à livrer. Les femmes du café sont là elles aussi à plusieurs reprises, elles aussi dans ce décors en mutation.
La parole de ces femmes casse cette crainte du changement imposé par la rénovation urbaine. Ce n’est pas la mutation de la rue qu’elles subissent, mais la mutation de leurs corps. Les lois du marché leur font finalement moins peur que celles de la nature.
Alors comme pour résister, Julian tend à sublimer ces femmes par l’image. Il les filme de près, se maquiller, séduire et attendre. Et ce avec une distance surprenante. Les protagonistes semblent l’impressionner, mener la discussion. Parfois, elles en disent trop peu. Souvent, elles en disent plus qu’ attendu, instaurant un rapport incessant entre l’intime et la distance, l’intérieur et l’extérieur, les certitudes et les doutes.
Je n’ai jamais quitté la foret, le temps subjectif
Le réalisateur se lance dans l’exercice ambitieux de la restitution des souvenirs des sens d’une personne face à son environnement. C’est ici l’impression singulière et personnelle de Martin qui est en jeu. Sa construction au cœur de la foret et de façon plus générale, la complémentarité contrariée des hommes et des arbres.
Certain parleront de « détours » par la fiction. Le terme paraît à demi adapté. Car comment effectuer ce voyage intérieur autrement qu’en cherchant dans le réel ce qui retranscrit le mieux des sensations? C’est bien là une affaire d’intime, à savoir « ce qui est contenu au plus profond d’un être ». Pour le faire sortir, il faut agencer le réel, le montrer de façon subjective, le rendre sensible.
Le réalisateur prête ses sensations à une voix, et à un corps. D’ailleurs plus une silhouette qu’un corps. La main, le toucher, la caméra subjective pour la vue. Une subjectivité affirmée jusqu’à ce que le spectateur atteigne lui aussi ces sensations. Il touche la matière, il respire l’air de la foret, il se sent seul face l’immensité des arbres, au cœur d’une ambiance sonore réelle et fantasmée. Il s’étonne des tableaux qui se composent sous ses yeux, du spectacle son et lumière permanent qui l’entoure. Il se rappelle qu’effectivement, cet environnement a pu infiltrer l’intime, le plus profond.
Le récit fictionel permet d’ouvrir sur des questions plus vastes. La mort cristallise les rapports entre les hommes et les arbres. Je t’aime moi non plus. L’arbre conditionne la vie et donne la mort. Le personnage reprend vie sous forme d’arbre, comme pour troquer le sang contre la sève et pour conditionner à son tour la vie des autres.
Cette impact de l’environnement sur la vie et sur la mort plonge le spectateur dans sa propre intimité. C’est d’abord les traces d’un passé trop encré, puis la mise en évidence des lieux qui nous survivent, de la force des éléments et de notre vulnérabilité.
Une salle bien remplie
La projection a donc eu lieu à l’Alhambra, comme chaque année. Les sièges étaient quasiment tous occupés. On a pu noter la présence de M1, de M2 bien sur, mais aussi de M3, M4, et même M5.
Bien des gens ont pu monter sur scène. D’abord la brochette d’étudiants qui a réalisé ces films et leurs équipes, soumis à l’éternel malaise devant les applaudissements de la salle, et les silences au moment des questions.
Il y a aussi eu l’équipe pédagogique. Une scénographie peu étudiée qui a mis cote à cote Pascal C et JB, rendant évidente la différence de taille entre l’un et l’autre. Des mouvements peu compréhensibles de Lola qui a couru à plusieurs reprises d’un bout à l’autre de la salle. Et surtout, le trou de mémoire devenu récurent au moment des remerciements. Quentin a encore failli passer à la trappe, lui qui finalement rend cette projection possible par son investissement au cœur des projets.
Certains protagonistes des films étaient aussi présents. Les adolescents de l’Estaque, les « acteurs » de Gare Gazette. Il y avait le corps et la voix de Je n’ai jamais quitté la foret. A la surprise générale, ni les femmes de la rue Curiole ni les arbres du film de Martin ne se sont présentés.
L’appel du buffet a écourté les questions du public. Les manques de victuailles ont été palliés par les ressources naturelles de Lola qui avait son stock de Champagne, elle qui en a eu dans le biberon et qui témoigne chaque jour un peu plus des ravages de l’alcool.
Tout le monde s’est enfin dirigé vers le cours Franklin Roosevelt vers minuit, pour une nuit de débauche, une de plus. Ah, les artistes.
.Jeanla Nonyme.